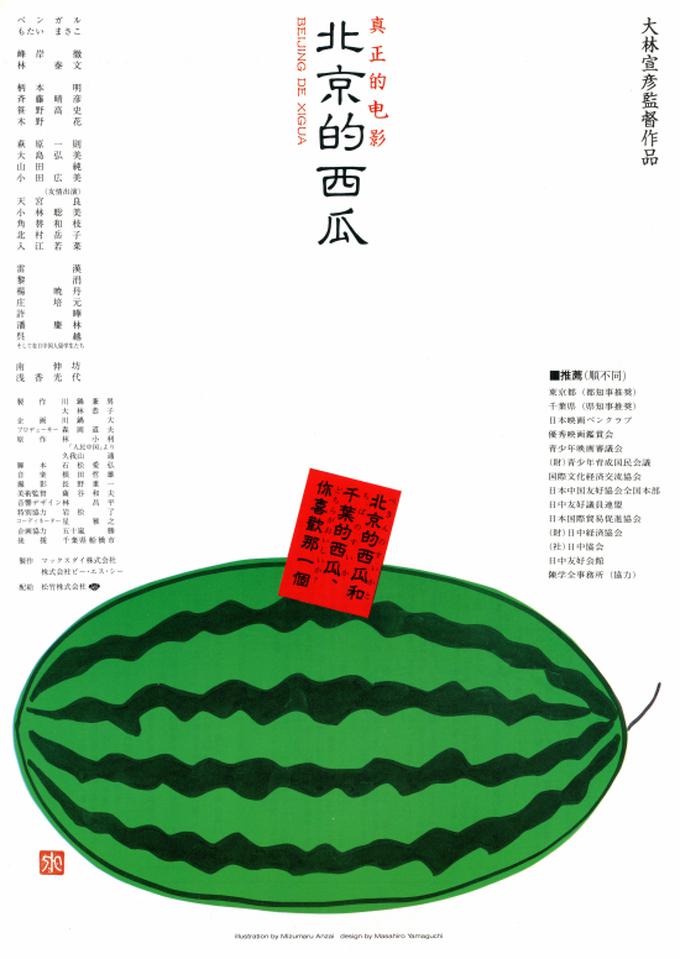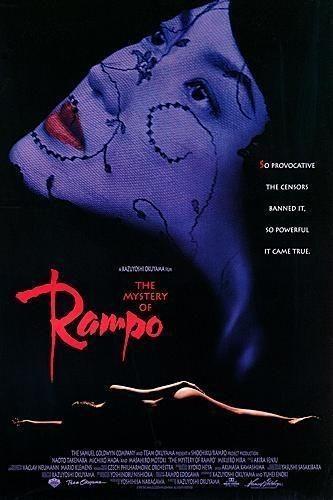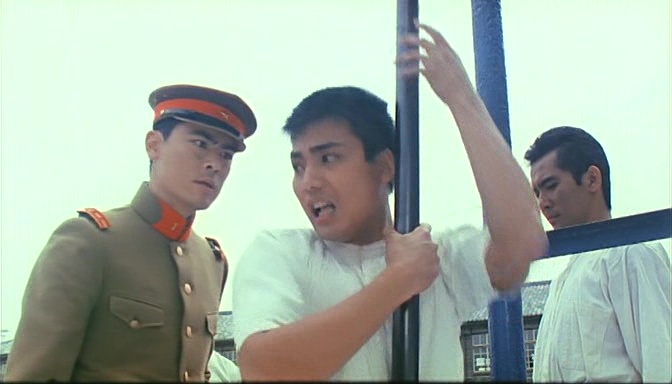Lisa dispose d'un jour avant d'aller à New-York, elle décide alors d'aller à Shibuya, un quartier populaire de Tokyo. Là-bas, elle pense pouvoir se faire de l'argent facilement en vendant ses sous-vêtements ou en tournant dans une vidéo mais tout ne se passe pas comme prévu et elle se fait voler ses économies. C'est alors qu'elle rencontre Raku qui va lui présenter Jonko afin de l'aider à récupérer son argent en une nuit...
Bounce Ko Gals est une véritable photographie d’un phénomène de société scandaleux dans le Japon des 90’s, Enjo kōsai. Ce terme désigne la pratique voyant des lycéennes tenir compagnie à des hommes mûrs moyennant finances, le « moment » partagé allant du plus trivial (karaoké, restaurant) à la vraie prostitution. Les lycéennes s’y adonnant sont pour la plupart des kogals, adolescentes à l’apparence fortement sexualisée notamment par leurs jupes d’uniformes très courtes, leur maquillage tapageur et leurs cheveux décolorés. Cette prostitution était à la fois une forme de rébellion et d’avilissement, par une quête superficielle dans l’achat de marque de luxe avec les « gains » de cette activité, mais aussi une manière schizophrène de s’affranchir de l’autorité parentale tout en étant le jouet d’adulte libidineux. Un film comme Love and Pop d’Hideaki Hanno (1998) se penchait de manière documentaire et stylisée sur le phénomène, détaillant les processus de mise en contact (via les telekuras (telephone clubs) où adultes et lycéennes pouvaient échanger, se communiquer leur profil, convenir de la « prestation » et se fixer rendez-vous) tout en rendant assez opaque la personnalité et les motivations des adolescentes qui s’y adonnaient. Bounce Ko Gals se montre moins clinique et plus porté sur les personnages tout en édulcorant pas sa toile de fond. Tout au long du film par son usage de la longue focale, Masato Harada place le spectateur dans une position de voyeur, accompagnant les pérégrinations des jeunes filles par une caméra s’attardant sur leurs jambes, rasant leur jupes si raccourcies. La scène d’ouverture donne le ton et les échanges décomplexés des lycéennes semblent finalement à la hauteur du filmage racoleur, puisqu’elles causent du rendez-vous avec les clients du jour, d’un énième avortement à subir ou des prochaines fringues à la mode qu’elles pourront s’acheter. Le récit évite ainsi le manichéisme puisque si le penchant trouble des adultes est inqualifiable, le cynisme et l’inconscience de certaines adolescentes y répondant l’est tout autant.

L’histoire va nous faire suivre trois héroïnes y étant confronté pour des motifs plus complexes que ce premier regard. Lisa (Yukiko Okamoto) est une jeune fille qu’on suppose en fugue et qui souhaite s’envoler pur New-York, terre de ses rêves. Pour compléter le budget de son voyage imminent, elle va basculer au cours de cette journée dans les différents business exploitant le fantasme adolescent, de la vente de ses sous-vêtements à une séance photo fétichiste, avant que la nuit venue la vraie prostitution ne reste comme seule solution pour vite gagner de l’argent. Elle va se lier d’amitié dans cette unité de temps à Laku (Yasue Sato), entremetteuse pour ses amies kogal mais elle-même encore innocente, et Jonko (Hitomi Satō). Chacune des héroïnes représentent une faillite des adultes les ayant poussés à ces extrémités. On le devinera au fil du récit avec Lisa écrasée par l’image de fille modèle que lui imposent ses parents, Laku au contraire confrontée à l’indifférence des siens face à ses absences scolaires et sorties nocturnes, et enfin Jonko qui découvre que son propre père est amateur de jeunes filles.

Masato Harada déploie toute l’imagerie artificielle précédemment évoquée en début de film à travers une narration chaotique, avant un recentrage dramatique brillant sur les trois adolescentes et la quête financière de Lisa. C’est une manière de nous faire comprendre que sous la désinvolture de certaines (le personnage de Maru (Shin Yazawa) satisfait de sa position d’objet sexuel et qui en paiera le prix) se cachent différents parcours intimes douloureux qui les ont menés à ce résultat. Dès qu’il s’agit de capturer les interactions de l’amitié immédiate et intense (typique des émotions à vif de l’enfance et l’adolescence) de son trio, Harada retrouve une candeur et une proximité tendre à travers la bande-son aérienne, les fondus enchaînés et le montage syncopé qui accompagnent les rires complices. C'est lorsque l'esthétique prend cette imagerie dynamique, à l'opposé des plans fixes les soumettant au regards concupiscents, que les héroïnes trouvent la liberté d'être et non plus d'appartenir - les deux sentiments s'entrecroisant lors de la scène suivant la rencontre avec le vieillard.

Cependant le sinistre monde des adultes va constamment rattraper nos héroïnes au cours de cette folle nuit. Il s’avère que cette prostitution précoce perturbe les affaires de l’industrie du sexe et plus précisément les yakuzas qui vont vite s’avérer menaçant. Cette dépravation des adultes en qui l’on ne peut avoir confiance s’illustre d’ailleurs par la nature des clients rencontrés, et dépouillés sans états d’âmes. Un salary-man fébrile, un vieillard sans demande sexuelle mais en quête d’auditrices pour ses horribles récits de proxénétisme, ou encore un membre du gouvernement, tous représentent une forme d’institution et constituent de détestables prédateurs. Subissant regards torves et propositions indécentes depuis le plus jeune âge, les kogals (comme le soulignera Jonko dans un dialogue cinglant) ont donc décidées de prendre leur part dans les perversions que les adultes leur imposent. Masato Harada par cette absence de jugement moral capture brillamment la fièvre autodestructrice qui pousse les adolescentes à cette vie, dont seul un objectif (la quête de New-York pour Lisa) peut faire réchapper.

Mais la beauté du film vient de sa dimension lumineuse, de sa croyance en des jours meilleurs à travers le lien profond unissant les héroïnes. Toutes se comprennent implicitement dans les raisons qui les ont réunies et le réalisateur notamment dans l’épilogue harmonieux ravive cette foi que l’on doit conserver en l’autre. Ce sera via les deux anges gardiens inattendus du récit, le dragueur maladroit Sap (Jun Murakami) et surtout le yakuza Oshima (Kōji Yakusho) paradoxalement seule figure adulte compréhensive (les chemins menant à cette voie criminelle étant tout aussi sinueux), bienveillante et sans arrière-pensées. Une œuvre brillante qui nous emmène des ténèbres clinquantes (et la nuit urbaine tokyoïte des 90’s saisie comme rarement) à un possible salut rédempteur qui nous fait croire au futur de ses héroïnes. 5/6